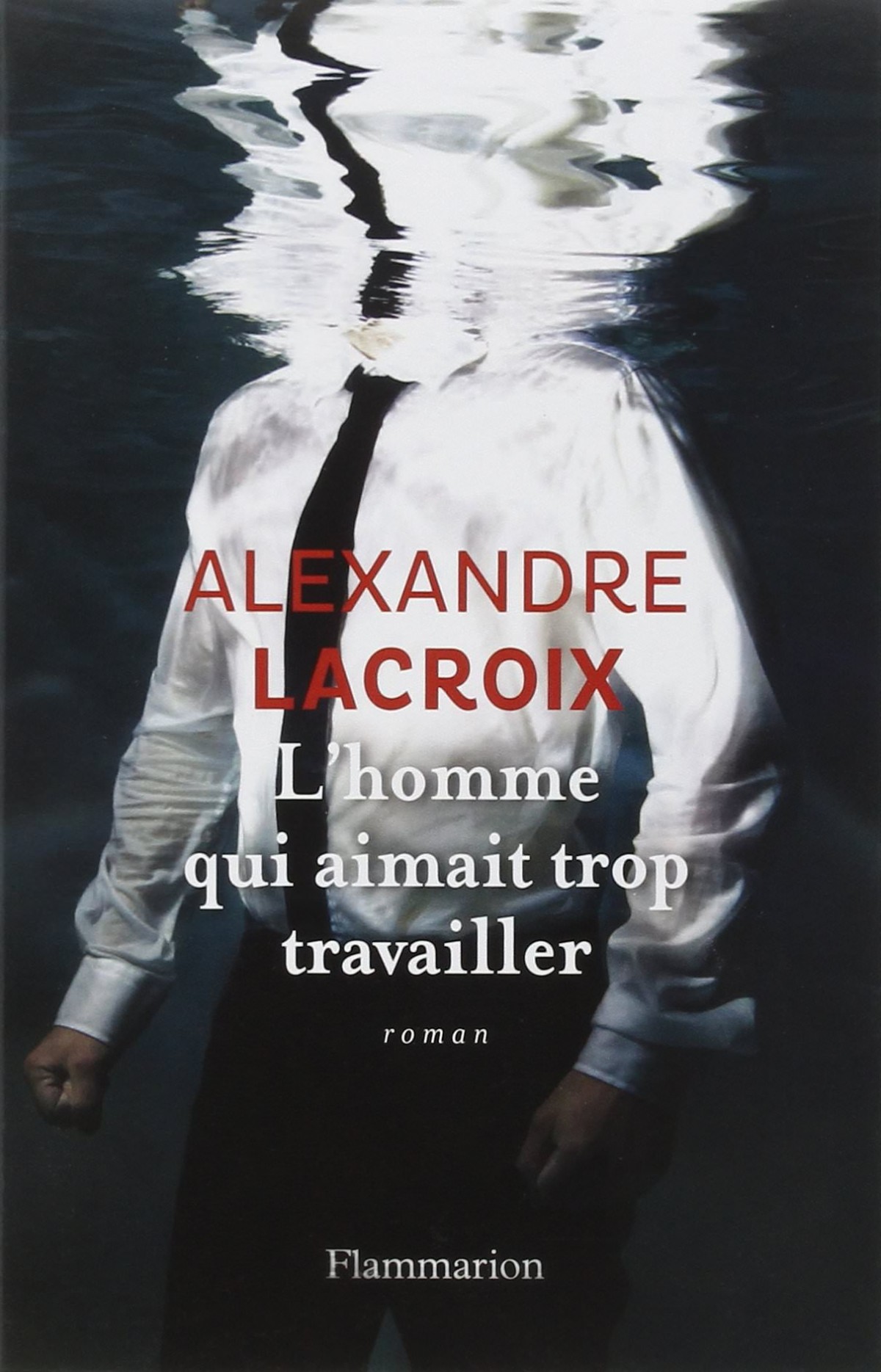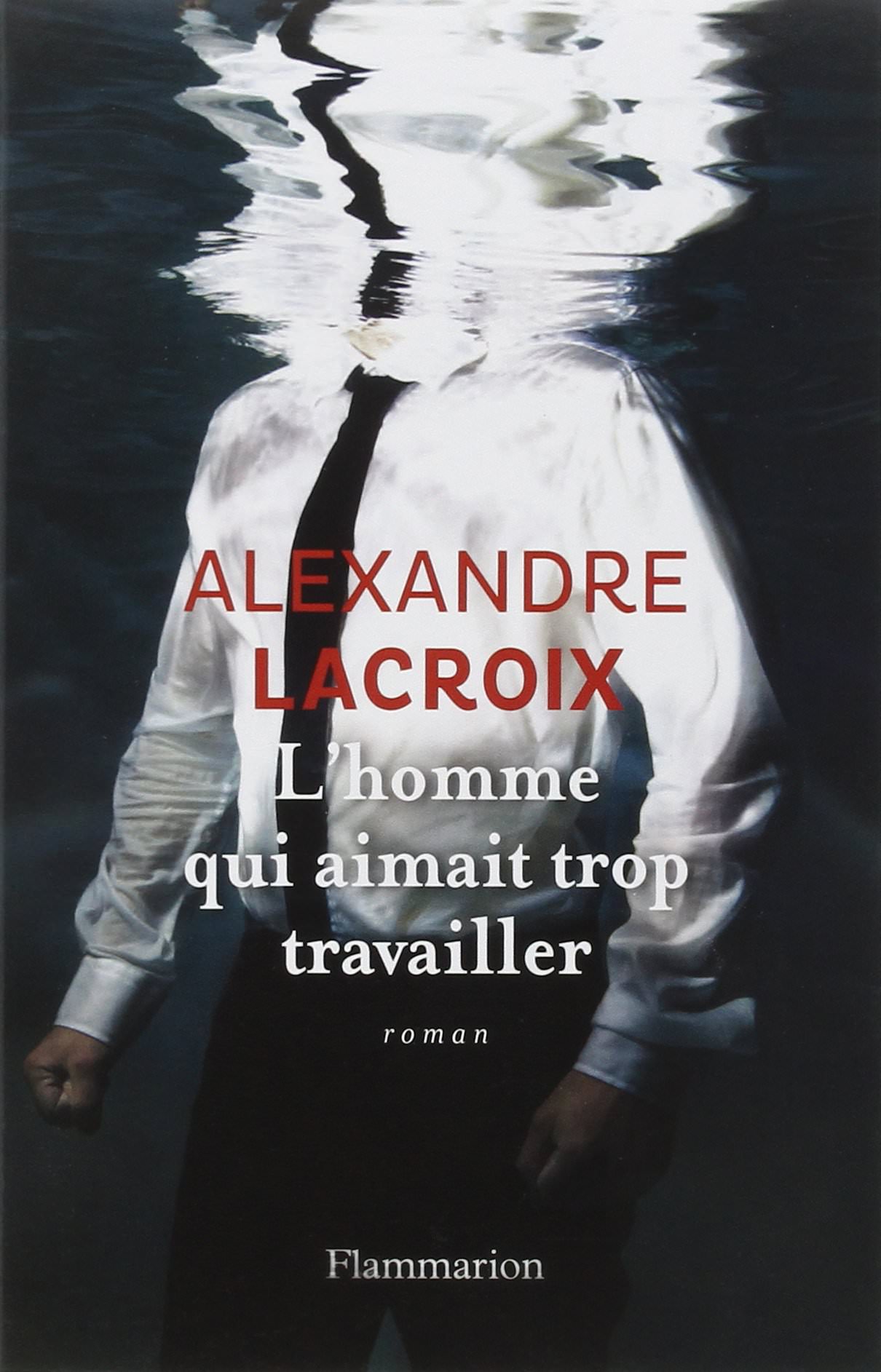L’extrait
« J’aime, j’adore travailler en open space. Eh oui, je sais ! Il est de bon ton de se lancer dans de longues jérémiades, dans de complaisantes complaintes au sujet de l’organisation décloisonnée des espaces de bureau. Adieu, la belle intimité d’antan ! L’open space soumettrait chacun à la surveillance de tous, ce serait une sorte de dictature inventée par les architectes d’intérieur. Pire, il créerait une source de distraction et de tension nuisant gravement à l’équilibre psychique. Voilà ce qu’on répète à l’envi – rien de plus faux, selon moi. Bon, évidemment, je n’irai pas jusqu’à prétendre que j’apprécie d’entendre tel collègue pianoter avec nervosité sur son bureau ou tel autre faire cliqueter son stylo-bille, et je reconnais que certaines conversations téléphoniques extraverties neutralisent l’étage pendant plusieurs minutes. Pourtant, j’aurais du mal à me passer de l’open space, auquel je me suis accoutumé comme à une drogue. Si je me retrouvais seul dans un bureau parallélépipédique, les symptômes du manque ne tarderaient pas à se manifester, j’aurais la sensation de manquer de liberté comme un hamster trottinant dans sa roue ; je serais moins en forme, aussi, car j’ai remarqué que les bureaux paysagers permettaient une circulation invisible de l’énergie : quand tout va bien, c’est-à-dire lorsque le brouhaha de l’étage est maîtrisé, régulier comme le ronronnement d’un vieux matou sympathique, il y a une sorte d’électricité palpable dans l’air, chacun est porté par la présence des autres, nous ne faisons plus qu’un seul corps, nous participons à une dynamique unique. Et c’est encore mieux que dans les sports d’équipe. Au volley ou au foot, on n’a la balle que pour de courtes apogées, et l’on est obligé de la repasser rapidement à un partenaire, sous peine d’être houspillé ; les vrais moments d’intensité sont rares. Travailler en open space, c’est pratiquer un sport collectif où il serait possible de jouer perso à l’infini, d’être sans cesse à l’attaque face aux cages. Qui dit mieux ? »
L’histoire
Sommer a un problème, mais il est le seul à l’ignorer : il travaille sans cesse. Directeur de la chaîne logistique d’une grande entreprise, il a oublié qu’une autre vie était possible. Il jongle entre les réunions commerciales, les coups de fil et les manœuvres malveillantes de son supérieur hiérarchique, et se targue de maîtriser son emploi du temps à la perfection. Bien sûr, il y a comme un paradoxe entre son engagement, à corps perdu, dans son métier et la dimension parfaitement dérisoire de celui-ci : vendre toujours plus de biscuits à toujours plus de clients. Mais il continue. Jusqu’à ce qu’un grain de sable vienne gripper cette machine bien huilée.
Une clé de lecture importante : ce roman est un remake, très transposé, de L’Étranger d’Albert Camus. Même nombre de parties, même nombre de chapitres, le personnage de Camus s’appelle Meursault et le héros de L’Homme qui aimait trop travailler Sommer, tous deux sont entourés d’un Raymond et d’une Marie. Certaines phrases de L’Étranger sont réinsérées dans le texte d’Alexandre Lacroix, si fondues qu’elles passent presque inaperçues, mais elles sont là tout de même.
En fait, le roman de Camus portait déjà sur l’aliénation, c’est-à-dire littéralement sur le fait qu’on puisse être étranger à soi-même, coupé de ses émotions. Ici, c’est l’open space et la vie de bureau qui génèrent cette aliénation, cette indifférence émotionnelle. Jusqu’à la catastrophe…
Revue de presse
Patrick Williams, Elle, mars 2015
« Alexandre Lacroix s’est emparé d’un sujet dont on a beaucoup parlé ces dernières années : le surmenage professionnel, le burn-out. Pourtant, son roman, L’Homme qui aimait trop travailler, se révèle bien plus qu’une simple dénonciation du monde du travail moderne. Dès les premières pages, le héros, Sommer, consulte de façon compulsive sa messagerie car, dit-il, ‘‘j’attends une réponse du monde’’. On décolle des considérations rase-moquette pour s’envoler vers des cimes métaphysiques. De même que Bret Easton Ellis avait écrit un American Psycho, Lacroix décrit un « Salaryman Psycho » dont les névroses semblent être une version extrême et fascinante des nôtres. Sommer est responsable de la chaîne logistique d’un fabricant de biscuits. Être froid, méprisant, obsédé par la performance, il déteste la faiblesse de ses collègues et éprouve un intense plaisir à toujours se dépasser. L’originalité de Lacroix est de nous montrer un homme intelligent, lucide, qui assume sans complexes sa folle passion du travail, tout en analysant avec une cruauté implacable et drolatiques ses failles et celles des autres (on se souvient que l’écrivain avait déjà démontré ses dons pour une autoanalyse impitoyable dans ses excellents livres autobiographiques, dont L’orfelin). Sommer nous ressemble et c’est glaçant. Évidemment, le pire arrivera… Directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, professeur à Sciences-Po, Alexandre Lacroix signe un roman incorrect, dérangeant, qui pose cette question scandaleuse : et si le surmenage n’avait rien de condamnable, restant la seule attitude vraiment héroïque en ce XXIe siècle si morne ? »
S. B., Le Parisien magazine, 30 avril 2015
« À trop travailler, on en oublie de vivre. Voilà la leçon que l’on pourrait tirer de cet ouvrage, savoureux portrait d’un quadragénaire hyperactif, Sommer, obsédé par les listes et les plannings. Le directeur de la rédaction du mensuel Philosophie Magazine nous livre une réflexion probante sur la société d’aujourd’hui. Il la décrit nombriliste, obnubilée par les formations élitistes comme les classes préparatoires, et adepte des anglicismes. ‘‘Il y a des êtres qui ne peuvent devenir humains que s’ils en bavent’’, déclare l’un des personnages féminins du roman. Serait-ce le cas de notre businessman au cœur de pierre ? »