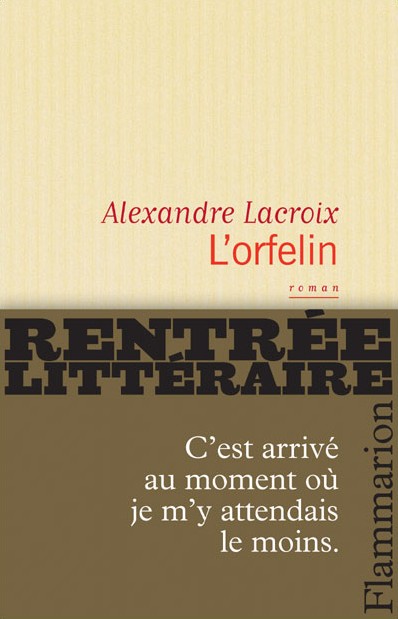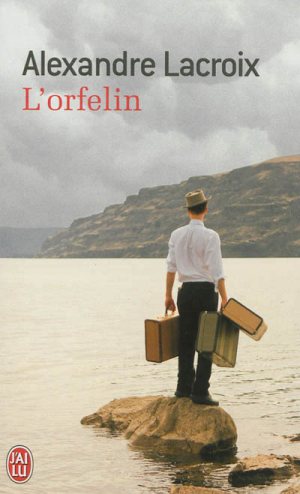L’extrait
« ‘‘Dis, papa, est-ce que je peux faire une photo ?
– Ouais… Fais bien attention à l’appareil.’’
Dans le sac à dos à lacets, un vieux Leica mécanique. Je décapsule l’objectif. Papa a jeté sa clope, il est assis, le buste légèrement penché devant lui, les mains jointes. Tenue vestimentaire : chaussettes rouges, bermuda de velours kaki, K-Way bleu marine. Clic.
Sans le savoir, je viens de faire la photo principale de mon père, celle que je conserverai avec une attention spéciale après sa mort. Dans un cadre, tantôt sur mon bureau, tantôt sur ma table de nuit, toujours à portée de main. Ce n’est pas qu’il y ait une belle lumière, ni que l’image soit réussie du point de vue artistique. Les lèvres ne sourient pas, le cadrage est imparfait, les genoux sont presque à hauteur des épaules, vu que le corps est plié. Pourtant, c’est cette photo-là qui résume le mieux l’essence de mon père. C’est bien son état d’esprit qui a été capturé, sa présence qui s’est imprimée sur le négatif. Quelque chose de plus que la simple surface de peau, que l’assemblage des traits.
On ne la localise pas, mais il suffit de regarder l’image pour la ressentir : la souffrance. C’est là un visage de souffrance pure, d’autant plus sensible que ce n’est pas de la douleur. Papa n’est pas crispé, ni contracté, ni gêné. C’est une souffrance totalement abandonnée, relâchée, qui se donne là pour elle-même et n’essaie pas de mentir. Une souffrance d’une douceur quasiment infinie. On voit qu’il souffre comme on peut voir parfois la mer et se dire : tiens, l’eau est noire. Comme on peut regarder une forêt au début de l’hiver et penser : tiens, les arbres ont déjà perdu leurs feuilles. Comme on peut lever les yeux vers la Voie lactée dans le ciel d’août et se rappeler : tiens, l’univers est immense. »
L’histoire
Trois journées. Trois étapes décisives dans la vie d’un homme. Une halte, au cours d’une traversée des Alpes à bicyclette, dans un camping municipal au bord du Lac Léman, en compagnie de deux femmes étranges. Un retour au pays natal, pour faire un dernier inventaire des affaires laissées par un père disparu vingt ans plus tôt. La naissance, dans une maternité parisienne, d’un petit garçon. Et chaque fois, le passé qui fait irruption de manière fracassante, les démons de l’enfance qui reviennent pour ébranler toutes les certitudes.
Revue de presse
Jean-Louis Ézine, Le Nouvel Observateur, 21 octobre 2010
« On peut séduire en se faisant détester. A tout le moins en essayant. C’est un trip. En littérature, rien n’est contraire à rien. Comme disait le regretté Manchette : ‘‘Tu peux pas savoir.’’ On trouve même des écrivains qui font tout pour se rendre antipathiques et, sous prétexte d’éviter les apitoiements que pourrait leur valoir une confession douloureuse, préfèrent se dépeindre d’emblée en mauvais garçons (ou en mauvaises filles). Alexandre Lacroix est de ces trompeurs forcenés. On se souvient de l’acide drôlerie de Quand j’étais nietzschéen, un récit autobiographique maquillé en roman, déjà, où ce philosophe jouait à vendre son âme au diable. La cinglante récidive qu’il propose dans L’orfelin révèle le motif familial de cette pénitence, dès l’incipit. On y découvre le narrateur en cycliste fluo baguenaudant à travers les Alpes pluvieuses, et se livrant à une débauche sordide dans un camping du Léman. Une passade aussi glauque que possible, dans une caravane délabrée, en manière d’exorcisme : son père fréquentait les prostituées. C’est même à cause de ça qu’il avait ramené la syphilis à la maison et l’avait refilée à sa femme, alors enceinte. Du narrateur, donc. Tout s’éclaire.
Façon de parler, dans la ténébreuse exploration des secrets de la parentèle, poursuivis et exposés sans complaisance ni même cette délectation affligée qui fait le charme convenu de l’exercice. Le philosophe avoue ne pas goûter ‘‘la métaphysique pompeuse de l’âme’’. C’est écrit sans tourner autour du pot, dans un style étrangleur et revêche. Comme la corde, exactement, à laquelle son père, un lettré compulsif, fou de Goethe et de Stendhal, et par une hypothèse masochiste plus doué que lui-même, s’il faut l’en croire, s’est pendu. À 44 ans, l’âge qu’avait Nietzsche quand il sombra dans la folie.
Tout se défait, mais tout se tient. C’est la plaie qui se creuse et se comble sans cesse dans le passage du temps, et laisse à cette prose violente une blessure ineffaçable, comme la corde a laissé son empreinte sur la poutre fatale malgré le brou de noix dont on l’a pudiquement noircie. Quant il était nietzschéen, l’auteur croyait à l’éternel retour. Foin de ces mélancolies. ‘‘Non, se défend-il, les vies que nous menons ne retourneront pas à leur point de départ. Elles sont faites d’arrachements successifs, par lesquels nous devons faire plusieurs fois le deuil de nos origines. Le village natal était autrefois une certitude, il est devenu un fantasme.’’
Avant le suicide paternel, Alexandre Lacroix, alors âgé de 7 ans, avait pressenti le drame dans un cahier d’écolier baptisé ‘‘L’orfelin’’. Le cahier s’est perdu. Pas le titre. Si la vie est sans retour, c’est tout de même une façon de fermer la boucle. Et de tirer, très fort. »
Guillaume Allary, Elle, 25 septembre 2010
« Il y a d’un côté le rédacteur en chef de Philosophie Magazine, auteur d’éditos pleins de sagesse. Et de l’autre l’écrivain, auteur d’une autobiographie en trois actes, où se déchaînent chaque fois un peu plus les passions dévastatrices. Acte I : De la supériorité des femmes, où Lacroix racontait sa rupture avec sa première femme. Acte II : Quand j’étais nietzschéen, récit de sa crise d’adolescence, où le philosophe revenait sur ses années Sorbonne. Acte III et aboutissement du zoom arrière : L’orfelin, où Lacroix replonge dans son enfance et revit son drame fondateur – le suicide de son père alors qu’il avait 11 ans. C’est son roman le plus violent, le plus abouti. Pour Lacroix, écrire semble vouloir dire : ne rien laisser dans l’ombre. Sa prose limpide jette une lumière crue sur les secrets de famille, décortique les pulsions qui le minent. Sa mère (avec qui il a, selon ses propres mots, ‘‘divorcé’’), son père (dont il décrit en détail les accès de folie), lui-même (il parle sans détour de son égocentrisme) : rien ni personne n’est épargné. Des romanciers qui, à ce point, mettent les mots au-dessus de la vie, au mépris des conséquences que leurs écrits ont dans leur quotidien, il y en a peu. Et ce sont évidemment les plus précieux. »